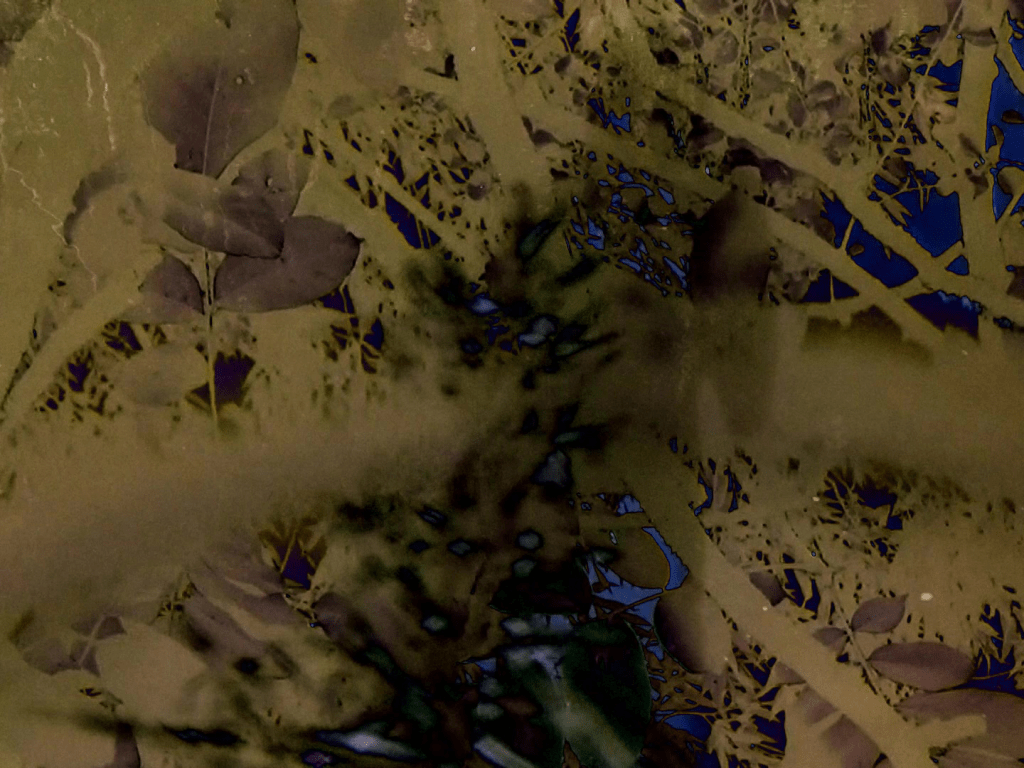En présentant mes films, il m’est arrivé d’avoir à faire à des discours curieux. Les paysages que je filmais s’y voyaient associés à une certaine idée de « nature« . La confusion de mes mots et de mes idées a trop longtemps contribué au feu de ces interprétations inexactes. Trop vite, j’eus concédé, par facilité sans doute, de parler de « nature » afin d’évoquer des éléments historiquement naturels, comme l’eau, l’atmosphère ou certains spécimens végétaux.
Quelle plus grande trahison à ces espaces que je croyais si bien connaître. Nous le savons pourtant, ces rivières (l’Oise, la Marne, la Seine…) sont parcourues de débris aquatiques, d’une pollution polymorphe englobant le chahut des péniches venant si fréquemment en remuer les eaux, et contribuer ainsi à y rendre impossible la richesse d’écosystèmes antérieurs. L’air qui siège sur ces horizons troubles est saturé par les rejets du trafic francilien, sans cesse agité par le bruit des transports (aériens, fluviaux, routiers, ferroviaires) et peuplé de particules nocives, aux quantités tout juste régulées, suffisamment nombreuses pour y troubler la température, affecter la santé d’organismes vivants et parfois même troubler leur champ de vision. La population végétale qui s’y développe est entourée d’un écosystème réduit, où la faune est globalement forcée à la discrétion et où l’espace au sol est souvent limité, contraint par des aménagements humains de toutes sortes (sentiers, bitumes, dégagements de voie, bâtisses, ponts, etc…) offrant fréquemment des zones d’évolution et de relation peu commodes, sujettes aux passages et aux perturbations.
En m’engageant dans les plus simples périphéries des villes environnantes, près des aménagements timides jonchés derrière le maillage des accès routiers et l’épais tissu des habitations humaines, les lieux que je rencontre, avec lesquels je viens souvent à travailler, sont des espaces intermédiaires, de croisement et de mutation. On y voit s’entrelacer des intentions humaines/industrielles et un certain nombre de reliquats naturels (fleuves, rivières, restes de bois ou de berges, etc…), qui, mêlés aux errances de la vie sur Terre, laissent place à des espèces ingrates. Ces paysages sont suffisamment impensés et marginaux pour présenter une certaine spontanéité du monde et du vivant. Leur caractère impur, « accidentellement » changé et perturbé par la main humaine les met, en théorie, hors d’atteinte d’une récupération dans le champ chimérique du « naturel ».
Si j’ai si longuement filmé les corps y résidant, ou traversant ces marges, c’est avant tout pour laisser place à des êtres en luttes, à leurs états de résistance, actuels et futurs, dans l’ère industrielle moderne : celles et ceux que nous méconsidérons, que nous écrasons, que nous obligeons à la métamorphose et à la restructuration (nécessairement aliénée par le monde humain) de leurs organismes. Ces corps sont composites, multiples, éclatés au sein de paysages qui eux-mêmes constituent des ensembles organiques et mouvants : en un sens, des supraorganismes (ou holobiontes). Ainsi, la notion de paysage que j’emploie cherche à décrire l’ensemble des systèmes vivants et non-vivants qui composent et entourent un point de perception choisi. Ce point peut être fondé sur des perceptions humaines ou non-humaines, il repose, en l’occurrence, sur les capacités des caméras et du cinématographe. Nous savons combien celles-ci sont limitées et en même temps puissantes : machines intenses de représentation qui engagent souvent un grand, nécessaire et périlleux travail pour les faire pleinement aboutir et donner alors une sensation et un aperçu juste et complexe d’une chose donnée, quelle que soit son échelle.
Ces lieux oubliés, en marge, où je travaille, m’ont d’abord accueillie, avant même de me parler et de me captiver. Ils sont de ces refuges intranquilles d’où peuvent surgir librement et simultanément les espèces et les corps délaissés, et s’y organiser, pour résister à travers ces brèches premières du monde urbain. Ce sont des espaces d’anticipation, échappant quelque part aux logiques dominantes – car on ne prévoit pas, la plupart du temps, que s’y développe encore cette vie, cet écosystème branlant, ou alors on ne s’en soucie pas suffisamment pour la « réguler » drastiquement.
Ces localisations, ces vivants, ces lieux, avec lesquels je coécris, sont profondément vulnérables. Ils peuvent à tout moment être rattrapés par le cours des choses : par le rythme effréné des aménagements humains et le contrôle grandissant sur les vies et les usages. Nombre de mes plans de tournage se virent chamboulés à l’arrivée de tractopelles, au détour d’une saison. Ces lieux, où l’on voit plus qu’ailleurs les altérations du monde et le passage des époques, sont des espaces où se traduisent, de manière très tangible, le développement tentaculaire du monde industriel sur les territoires et la partialité – abjecte et méprisante, car étrangère et ignorante – de celles et ceux qui en sont à l’initiative.
Ces paysages ne sont évidemment pas naturels – voilà une tâche ardue que de trouver aujourd’hui quelque chose de proprement naturel. Depuis l’ère industrielle et le bouleversement planétaire des données climatiques, depuis l’appropriation et le design de l’essentiel des paysages terrestres par l’espèce humaine, et surtout, même, depuis l’invention de l’agriculture, la dissociation nature/culture n’a cessé de s’avérer détachée de la réalité de nos relations. Ce concept clé, profondément artificiel, fondateur dans le rapport à l’environnement du monde occidental, est sans doute aussi trompeur et que difficile à contourner, tant il joue un rôle central dans nos représentations. N’est-ce pas là, depuis longtemps, l’éléphant dans la pièce ?
Comment qualifier alors le statut de ce monde de toutes parts perturbé ? Comme beaucoup Donna Haraway a proposé une manière d’esquiver le chemin perfide de la dualité nature/culture, par une pirouette aussi ludique que révélatrice, consistant à retirer cette ponctuation qui sépare ou oppose les deux termes. Ainsi, en les faisant fusionner en un mot synthèse, la « natureculture« , en rendant impossible d’évoquer l’un sans l’autre, Donna Haraway nous invite à mieux décrire et à mieux penser les réalités complexes et plurielles de notre monde contemporain. Le trouble dans lequel nous vivons.
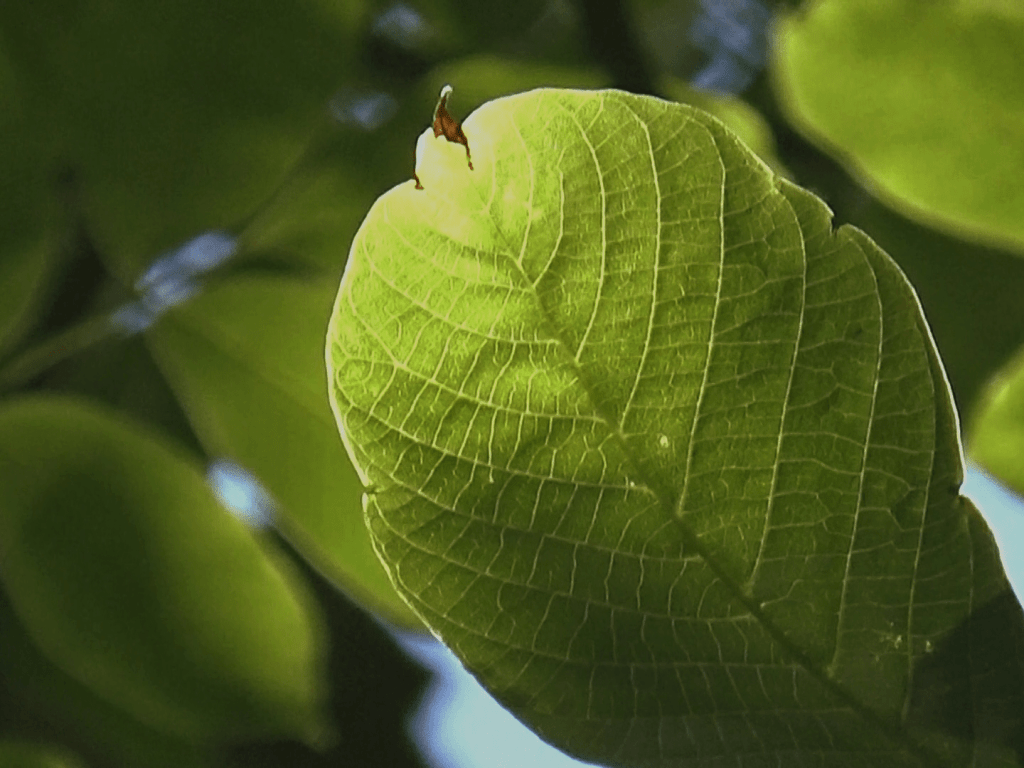
Le caractère « natureculturel » des espaces que filme n’enlève rien à ce premier problème, évoqué plus haut : ces paysages si hybrides et troubles sont interprétés comme des vues du monde naturel. Ce hiatus révèle l’ampleur du chantier de mise en scène et de médiation à acter pour délivrer de manière sensible et plus immédiate l’actualité des pensées et récits nouveaux que nous voulons partager. Dans ce travail vers de nouvelles représentations, plus viables dans ce monde mouvant, nous engageons un rapport de force avec les images et les notions pré-existantes.
Les considérations communes sur « la nature » et le paysage sont une toxine difficile à parer. Comment peut-on penser qu’une rivière ainsi traitée est naturelle ? À quelle époque ancestrale cela renvoie-t-il ? Comment peut-on penser que les canicules à répétition ou le climat, ainsi altéré, relèvent de la nature ou des « puissances naturelles » ? Les fractures qui habitent notre pensée sont les premiers obstacles à l’établissement de nouvelles manières de sentir ce monde dans lequel nous vivons. Les fautes, les échecs et les approximations, sur le chemin pour s’extraire de leur violence, semblent a priori inévitables : c’est ce chaos, ainsi généré, qui appelle à de nouvelles images, d’autres récits, d’autres regards.
Pour ne pas se perdre, au centre de ces grands mouvements, l’appui des paysages réels, et de leur réalité en elle-même, m’a toujours semblé être commode. En filmant sensiblement ces espaces hétéroclites, nous travaillons déjà à l’établissement d’une nouvelle esthétique. Ces marges soudaines de la civilisation industrielle sont le visage, par la périphérie, de sa féroce actualité : ces horizons sciemment méconsidérées, aménagées sans vergogne, si fortement révélateurs de nos politiques (et de leur caractère impérialiste, spéciste, capitaliste et colonial). Trouver les moyens d’une résonance à partir de lieux et de réalités que nous connaissons et avec lesquels nous pouvons travailler en profondeur peut ouvrir la voie, au détour de ces richesses et de ces pluralités (ce trouble), vers esthétique qui engage enfin l’état actuel, global, passé et futur, de nos modes de relation.
Dans mes films, le recours quasi systématique aux fortes lumières d’été et mon travail de la piste sonore (où s’y déforment la faune, le temps et les machines), cherchent à aller dans ce sens. Ils tendent à déplacer la teneur visuelle et sonore des paysages avec lesquels je collabore, pour en épanouir autant que possible le potentiel virtuel : la possibilité en eux de sentir ou d’entrevoir, presque imperceptiblement peut-être, d’autres temporalités et d’autres configurations, jumelles, futures ou passées. Ce projet nécessite évidemment un travail au long cours, dans lequel je ne suis, pour ma part, encore qu’au début – à travailler toujours depuis ces premières brèches de liberté, en marge des marges… Nous aurions pu être davantage aidé·es par les générations qui nous précèdent. Mais, si les plus figures les plus connues travaillent pour la plupart peu ou mal sur les questions écologiques ou décoloniales, nous nous devons de valoriser l’œuvre de nos aîné·es méconnu·es qui ont si grandement entamé, consciemment ou non, les recherches et la révolution dans laquelle nous devons nous placer (voir mentions en fin d’article).
Un autre allié de taille, dans une telle reconstruction, est ainsi logé dans les récits qui nous précèdent : non seulement les formes cinématographiques, mais plus généralement, les formes préexistantes de pensée et de représentation qu’il convient de reconnaître (pour s’appuyer sur elles ou pour en tirer des leçons) : formes par lesquelles nous pouvons contribuer à créoliser l’imaginaire mortifère dominant, pour en guérir les lacunes béantes et ainsi aider à faire cicatriser les cercles de violence dans lesquels nous semblons enfermé·es. Chez Edouard Glissant, la créolisation est une réponse émancipatoire, plurielle et syncrétique face à un traumatisme partagé (celui de la modernité coloniale). J’aime imaginer que d’autres formes de créolisation sont à-même de survenir – des formes qui porteraient un autre nom, n’étant de fait plus vraiment créoles : naissant d’autres contextes, mais jaillissant de processus comparablement nommés.
En cela, le travail du cinéma a beaucoup à faire (et notamment le travail des jeunes générations, particulièrement des pays et cultures jusque-là minorés, ce qui fait appel, aussi, à la solidarité des récits et surtout des structures occidentales, pour libérer des espaces de représentation, selon des modalités ouvertes et non-imposées).
Les enjeux du regard ou de la représentation sont évidemment dans l’essence du cinématographe. Celui-ci s’est d’ailleurs déjà avéré capable de réveiller une forme d’animisme endormie sous l’ère industrielle. On peut se souvenir ainsi des émerveillements et autres frémissement de la pensée provoqués par les études chrono-photographiques et cinématographiques sur la croissance et le mouvement des végétaux ; ou encore du travail fondamental de cinéastes comme Jean Epstein, au creux de ce sillon du monde trépidant tracé depuis les vues Lumière. Un siècle plus tard, ce sont sans doute ces mêmes sensations du cinéma primitif, révélations subtiles et détonations éternelles, que font vibrer des cinéastes comme Apichatpong Weerasethakul (lequel travaille à la frontière des perceptions humaines et aux prémisses du monde non-humain). L’association « natureculturelle » de la lumière et de la technique, du rêve et la narration, du réel et du monde des visions, sont les bases évidentes d’un nouveau travail, aussi cyborg que nous, pour rétablir un lien nécessaire entre les vivants : une cicatrisation philosophique et physiologique de la biocénose planétaire pour se mieux soutenir, et se mieux devenir.

Dans mon film La Respiration de Cristal, le personnage avec lequel nous entrons en résonance se baigne dans l’Oise, là où passent encore les péniches, comme le traduit lui-même l’environnement : certains panneaux, certains aménagements, certains mouvements de l’eau, la rivière cet écran d’un léger brun, trouble et miroitant, où le sable et la vase sont si souvent remués sous la puissance des vagues passagères causées par x ou y. Les pouvoirs sensitifs que ce personnage développe ne sont pas tant liés aux vivants qu’il fréquente qu’à la qualité impropre, altérée et hybride de leur rencontre : croisement « natureculturel » d’où émergent des anomalies et des possibilités nouvelles, affectant le système sensoriel et émotionnel, touchant à la nature précise des cellules qui composent un corps.
Si l’on écoute ce personnage, on devine que son asthme (apparemment causé par l’exposition aux pesticides) et son statut hormonal trouble ne semblent pas tout à fait extérieurs à ces événements nouveaux. Ces relations inattendues s’enracinent dans l’agencement du monde tel qu’il est, enrôlant les composants et le tout-venant de notre réalité, et outrepassant ainsi le monde déjà-pensé au travers de métamorphoses imprévisibles et irréversibles. La nature nouvelle des corps et des organismes naît de ces cohabitations incontrôlées. Ce genre de réagencement de nos modes de relation et de réflexion ne nous est d’ailleurs pas si étranger. La façon dont la révolution numérique a bouleversé notre manière de se lier au monde semble être déjà d’une magnitude similaire – d’autant que celle-ci touche si profondément à des parts intimes de nous-même et de notre fonctionnement primitif (neurologique, cérébral, etc).
Il m’arrive souvent de dériver sur mon rapport à la technologie lorsque l’on me questionne sur « la nature ». Ces concepts fréquemment opposés répondent, comme nous l’avons vu, d’une seule et même question. Cela n’est pas toujours clair. Nous devons pourtant nous habituer à parler indistinctement de biotopes, de cybertopes et de technotopes. Comme l’essentiel des organismes, nous évoluons aujourd’hui dans un écosystème radicalement orienté par les aménagements qui nous entourent et qui composent les champs de notre existence. Le fantasme de pureté qui habite le concept de nature semble être une bien fatale déconnexion. Comment se moins bien saisir de ce qui constitue notre réalité ? L’acceptation du caractère trouble et hybride de notre univers constitue probablement un premier pas essentiel pour épouser de façon plus aboutie le simple état des choses – et mettre alors un peu plus à distance le vide béant de notre civilisation du contrôle. Cette modeste ambition que de se rendre compte des choses qui nous entourent (reconnaître-pour-soi) et d’agir en conséquence (reconnaître-en-soi) dessine une bonne part du matérialisme animiste dans lequel je souhaite m’inscrire. Cet enjeu nécessite une humilité et une capacité critique qui impliquent évidemment de repenser et de ré-accorder nos modes d’action et nos méthodologies. Il relève en cela d’une effusion révolutionnaire.
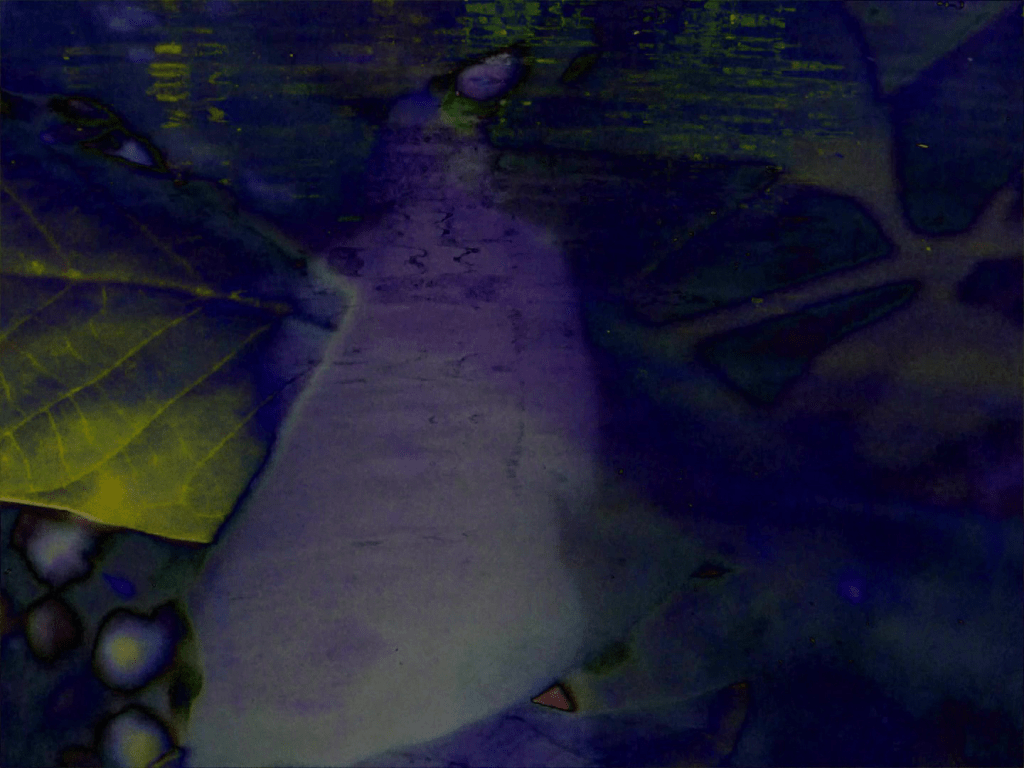
Il ne m’a jamais été possible de construire un film sans en définir d’abord les lieux, la carte, l’itinéraire, et le scénariser en conséquence – si encore je le n’allais pas directement tourner. Mes tournages les plus structurés furent avant tout le fruit d’efforts soutenus de repérage et de fréquentation. Faire des films m’a permis d’apprendre à sentir les lieux qui m’ont accueillie. C’est en travaillant à l’élaboration de mes différents projets, et en développant une activité intense et curieuse de repérage et d’enregistrement, que j’ai pu agrandir ma perception des espaces et des environnements que je parcoure. L’élaboration d’un lien et d’une sensibilité à nos entours ne saurait être un travail pur et proprement naturel : il ne saurait être parfaitement détaché des réalités techniques, mixtes et natureculturelles qui nos entourent. De la même manière que ma caméra, mon ordinateur et mes micros m’ont aidée, cette démarche ne doit pas se priver d’être d’abord indirecte, impure, pour mieux se pervertir d’hybridations et de métamorphoses.
C’est par le détour de notre sensibilité cyborg, en épousant d’une manière plus poussée les perceptions altérées et discriminantes avec lesquelles nous faisons lien, que nous pouvons établir, petit à petit, une façon particulière et réelle de comprendre et de considérer notre environnement.
Ainsi, j’en suis venue à travailler aujourd’hui, et depuis un peu plus d’un an, dans un mode de production plus organique et spontané, nourri par la connaissance poussée des territoires avec lesquels je collabore. Les lieux où j’ai l’habitude de filmer, ces lieux que traverse les jours où mes émotions sont les plus ouvertes, avec ou sans caméra, sont devenus des équipiers de longues date – toujours mus par les saisons et le mouvement des choses, mais dont je connais les expressions singulières, les regrets et les angles révélateurs. Sans doute ce lien pourrait-il encore s’épaissir au fur et à mesure des années, ou muter… Quelle différence d’ailleurs avec les autres enjeux de casting et de relation (choses que l’on connaît surtout sous l’angle humain) qu’engage l’aventure d’un film ?

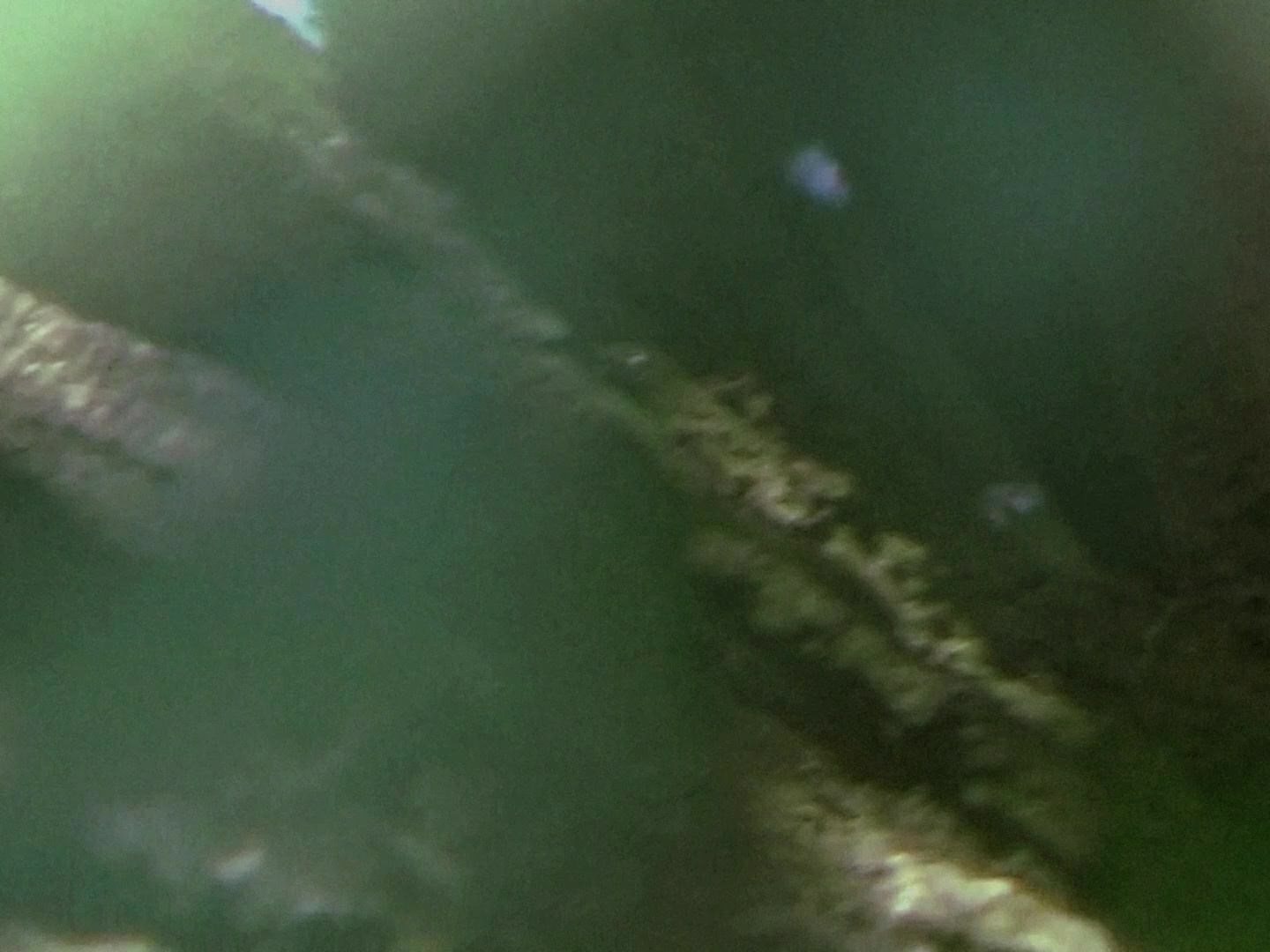
Aujourd’hui, je suis loin des lieux que je fréquente et que je cartographie depuis presque quatre ans. Là où je travaille actuellement, en Vénétie, l’atmosphère est particulièrement polluée. Les nombreux aérosols présents dans l’air sec qui jonche la vallée empêchent parfois de percevoir les montagnes massives qui nous observent à seulement 27km de là. Les zones industrielles et résidentielles y sont comme partout desservies par des artères routières aussi conséquentes que lacunaires. Celles-ci, évidemment, dictent le territoire et continuent de se développer, si bien qu’il se construit, non loin de là, une nouvelle autoroute, dont le parcours abrupt et rempli de graviers rappelle le lit asséché de la rivière, cinq ou six kilomètres plus haut.
Les repérages que je mène ici, traversant les périphéries silencieuses entourant certains canaux, cherchent à développer encore, dans un contexte nouveau et donc périlleux, cette nouvelle manière de construire un cinéma sensible aux paysages que je cherche à faire grandir : ne plus scénariser en considérant les territoires comme des ressources cinématographiques ou les simples fondations de notre mise en scène. Ne plus se munir de trop d’intentions préalables pour apprendre à connaître un paysage, et réfléchir ensuite collectivement, d’après une connaissance de fond. Épouser ce que nous connaissons du monde et collaborer plus pleinement avec ses espaces, travailler d’une manière plus poussée avec ses éléments et ses vivants de toutes sortes, d’une manière plus fluide, plus intuitive, fondée sur la connaissance mutuelle développée en amont du tournage, dans la vie.
Ces timides canaux, qui parcourent vigoureusement la région, m’évoquent des souvenirs brumeux de la ville à canaux de Yanagawa, filmée par Isao Takahata. Pour s’établir sur ces terres sujettes aux inondations, la population locale a dû trouver de nouveaux agencements territoriaux que le documentaire de Takahata (L’histoire des canaux de Yanagawa, 1987) évoque généreusement. La création de cet espace « natureculturel » n’a pas que domestiqué un sol défavorable à la sédentarisation ; elle a aussi, en retour, obligé les habitants et les habitantes de la ville à repenser leurs modes de vie et leur rapport aux canaux, pour respecter cet élément fluide et poreux, alors sévèrement pollué, liant tous les vivants de ce même territoire.
La relative passivité des éléments qui nous entourent, d’après notre échelle de considération, et notre incapacité à les écouter convenablement, conduisent à des rapports souvent unilatéraux. C’est cette verticalité sans circulation et sans discussion qu’il faut contrer autant que possible, en cherchant, autour de soi, des espaces où se traduisent sensiblement le trouble et la complexité dans lesquels nous vivons. De là peut-on œuvrer à l’effritement nécessaire de nos considérations les plus fallacieuses, mortifères et insensibles, pour épouser dans leur richesse les situations que nous traversons – ce monde dont nous faisons partie.


« Mes deux films produits cette année […] regardent chacun leur solstice respectif. Le premier sort de l’ombre, retrouve enfin les rayons solaires, et se compose un corps sous les briques qui s’effondrent. Le second laisse place, une fois l’hiver présent à nouveau, aux zones fertiles qui pouvaient subsister, aux seuils humides des rivières, aux zones inondables, aux périphéries plus ou moins travaillées par la main humaine. À tout ce qui pourrait s’assécher mais ne se laissera pas faire. À ces hybrides, ces lieux non-binaires, ces espaces que je comprends et qui m’ont aimablement m’accueillie pour y faire des films. Viendra peut-être demain l’épanouissement du temps politique qu’ils ont entamé. » – 31 Déc 2020
Lire aussi
Quels paysages sont encore possibles ? – Vers un cinéma cosmo-symbiotique, Paradoscope, Mars 2021
Quelques ressources théoriques
Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon, 1961
Vaster than Empires, Ursula K. Le Guin, 1971
Poétique de la Relation, Édouard Glissant, 1990
Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Donna Haraway, 1991
Par-delà nature et culture, Philippe Descola, 2005
When species meet, Donna Haraway, 2008
L’horizon, Céline Flécheux, 2014
Argonauts, Maggie Nelson, 2015
Une écologie décoloniale – Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand, 2019
Puissance du végétal et cinéma animiste – La vitalité révélée par la technique, Teresa Castro, Perig Pitrou, Marie Rebecchi (dir.), 2020
L’invention du colonialisme vert – Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain, Guillaume Blanc, 2020
Les formes du visible: une anthropologie de la figuration, Philippe Descola, 2021
Hors-Sol les nerfs sont tendus – La leçon des images de Seumboy, Centre Pompidou / Seumboy Vrainom :€, 2021 (Conférence performée réalisée durant la 16ème édition du festival Hors-Piste au Centre Pompidou autour de la thématique « L’écologie des images »)
Les travaux de Francis Hallé (Éloge de la plante, Du bon usage des arbres, etc…)
(cinéastes)
Masao Adachi, Chantal Akerman, Kenneth Anger, Govindan Aravindan, Jean-Pierre Bekolo, James Benning, Shu Lea Cheang, Mary Helena Clark, Charlotte Clermont, Maya Deren, Victor Erice, Studio Ghibli, Jean-Luc Godard, Barbara Hammer, Sumiko Haneda, Hong Kong Documentary Filmmakers, Hou Hsiao-hsien, Hu Bo, Peter B. Hutton, Gakuryu Ishii, Jia Zhangke, Mani Kaul, Klonaris/Thomadaki, Teruo Koike, Simon Liu, Rose Lowder, Sarah Maldoror, Toshio Matsumoto, Laura Mulvey, Nobuhiko Obayashi, Ogawa Pro, Kohei Oguri, Ulrike Ottinger, Sergei Parajanov, Franco Piavoli, Makoto Sato, Daichi Saito, Michael Snow, Straub & Huillet, Malena Szlam, Trinh T. Minh-ha, Noriaki Tsuchimoto, Ana Vaz, John Waters, Apichatpong Weerasethakul, Hiroshi Yamazaki, Edward Yang…
Films dont sont tirées les images
Essentiel de l’article :
La Respiration de Cristal · 2021 · 33 min
Deux dernières images :
Our Merging hearts · Mars 2022 · 7 min // La Respiration de Cristal · 2021 · 33 min
Ci-dessous :
Our Merging hearts · Mars 2022 · 7 min
Remerciements
Pauli · Vincent Gérard · Corinne Le Neün · Fabrica · Charlotte Charbonnel · Jee Yeongseo · Stefano Miraglia · Carlos Casas

© Camille Simon Baudry · Tous droits réservés · avril 2022